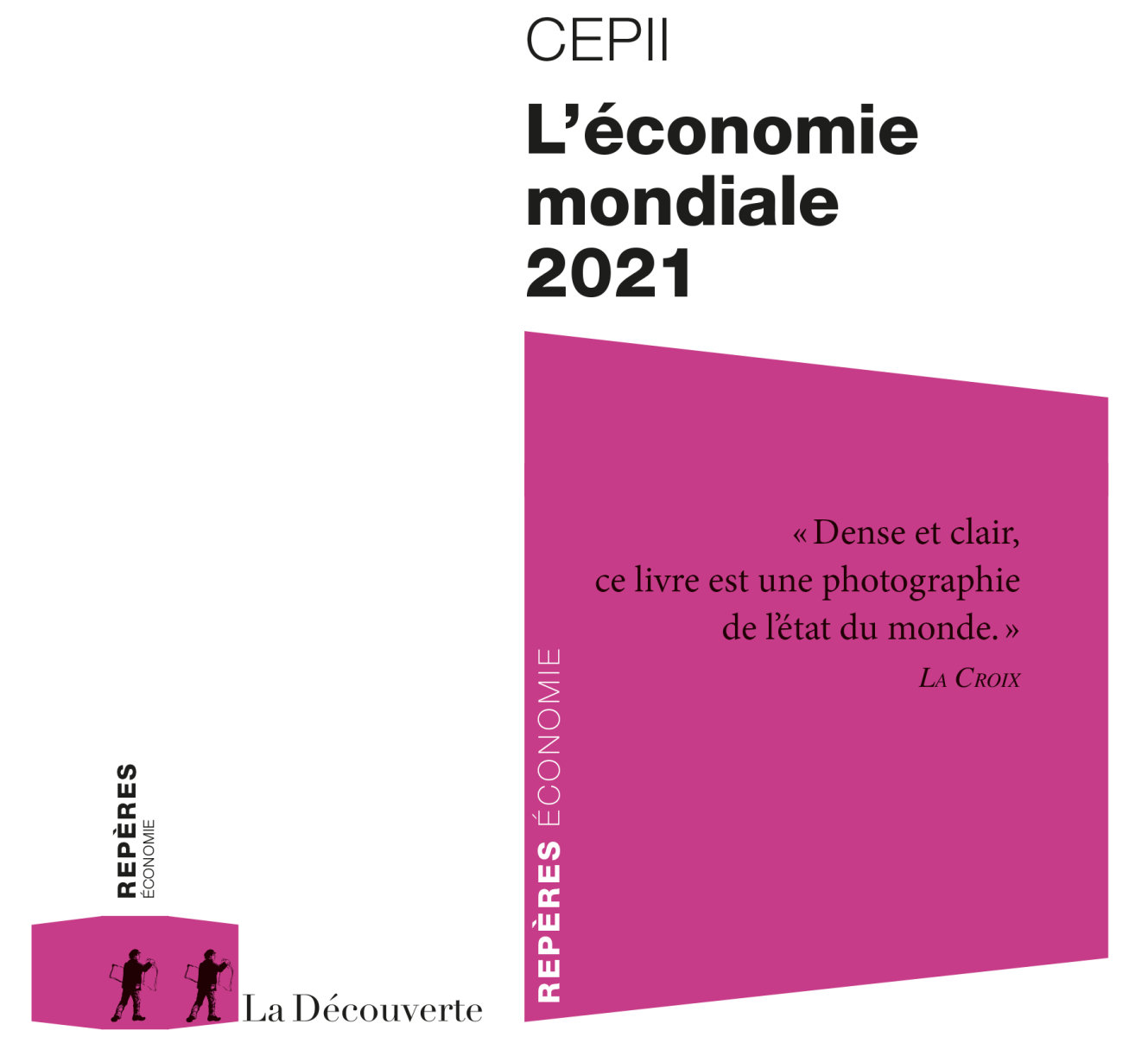
Que nous réserve L'économie mondiale 2021 ? Conversation avec Isabelle Bensidoun et Jézabel Couppey-Soubeyran
Le livre sera en librairie le 10 septembre.
Le 9 septembre, le CEPII vous invite à la conférence de présentation de cet ouvrage : pour vous inscrire cliquez ici.
The Conversation : quelles données à disposition permettent selon vous de saisir l’ampleur du choc économique que nous vivons ?
Sébastien Jean, directeur du CEPII, dans la traditionnelle vue d’ensemble qui ouvre le livre, évoque un désastre économique. Il faut dire que la chute des revenus prévue pour 2020 est hors normes, avec plus de 90 % des pays qui seront confrontés à une baisse de leur PIB par tête. Le choc sur l’emploi sera aussi massif avec un taux de chômage dans les pays de l’OCDE qui a déjà plus que doublé entre la fin 2019 et juin 2020 pour passer de 5,3 % à 11,4 %.
Dans les pays en développement, où l’emploi informel est bien souvent la norme, les conséquences sur les conditions de vie des plus démunis seront dévastatrices avec le glissement de 40 à 60 millions de personnes dans l’extrême pauvreté, d’après la Banque mondiale.
TC : Pourtant, les gouvernements et les banques centrales ont réagi promptement et fortement face à ce cataclysme économique ?
En effet. Les mesures budgétaires annoncées représentaient en juin 2020 un total mondial sans précédent de 11 000 milliards de dollars qui devrait porter la somme des déficits publics à 13,9 % du PIB mondial : du jamais-vu en temps de paix ! Les banques centrales n’ont pas lésiné non plus. La Banque centrale européenne s’est engagée sur un nouveau programme d’achat d’actifs de 750 milliards d’euros assorti de règles très assouplies, porté début juin à 1 350 milliards d’euros.
Aux États-Unis, la Réserve fédérale a été plus radicale encore lorsqu’elle a fait savoir qu’elle interviendrait sans limitation de montant pour restaurer un fonctionnement apaisé des marchés. Quant aux banques centrales des économies émergentes, une douzaine d’entre elles ont rejoint celles des économies avancées dans la pratique de l’assouplissement quantitatif pour soutenir les marchés et l’activité économique.
Alors que la situation sanitaire reste toujours très incertaine, une chose est sûre, le désastre provoqué par la pandémie de Covid-19 laissera des traces durables. Face à la stagnation séculaire (période durable de faible croissance), qui se confirme, espérons que les gouvernements sauront, au-delà des mesures de soutien, engager les politiques de relance qui s’imposent dans un contexte de taux d’intérêt extrêmement bas pour éviter que ne s’installe un cercle vicieux de ralentissement.
TC : Cette pandémie a jeté une lumière crue sur les interdépendances qui façonnent aujourd’hui l’économie mondiale et les vulnérabilités qui leur sont associées. Est-ce le début de la fin de la mondialisation commerciale ?
Sans doute pas et il est de toute façon trop tôt pour le savoir, mais avec cette crise, la mondialisation et plus exactement l’organisation internationale des chaînes de valeur caractérisée par une fragmentation entre plusieurs pays des différentes étapes de production vont entrer dans une phase nouvelle. Que l’on y voie un moteur de développement et d’innovation ou une dérive lourde de menaces, l’essor des chaînes de valeur mondiales est la signature la plus marquante des transformations économiques des trois dernières décennies, qui ont ouvert une nouvelle ère de la mondialisation.
Les relations macroéconomiques internationales, les politiques de développement et la répartition des revenus en ont été profondément transformées. La crise sanitaire amène à reconsidérer le rapport coûts-bénéfices de cette organisation internationale des chaînes de valeur, en faisant effectivement prendre conscience du danger d’une dépendance trop forte de la production, lorsque celle-ci concerne par exemple des médicaments ou des masques que l’on ne peut plus réaliser de manière autonome.
Pour Sébastien Jean, Ariell Reshef et Gianluca Santoni, si le glas de cette ère des chaînes de valeur n’a pas encore sonné, indéniablement une phase nouvelle est en train de s’ouvrir où la sacralisation de l’optimisation des coûts pourrait quelque peu s’effacer devant les vulnérabilités que cette organisation de la production à l’échelle mondiale implique.
TC : Cette prise de conscience des conséquences de notre dépendance à la production étrangère a conduit à relancer le débat autour des questions de relocalisation, réindustrialisation… Ces questions sont-elles pertinentes ? Doivent-elles être réglées au niveau national ? Européen ? De quelle manière ?
La désindustrialisation est un processus qui concerne tous les pays avancés, mais certains comme la France ont connu une désindustrialisation accélérée. C’est ce que l’on observe lorsque l’on compare l’évolution de la part de l’industrie dans le PIB en France, passée de 17,5 % en 1995 à 11 % en 2019, et en Allemagne, où elle est restée constante à 23 %.
Pour François Geerolf et Thomas Grjebine, cette désindustrialisation accélérée est intimement liée aux déficits extérieurs persistants : pour un niveau de demande interne donnée, un déficit extérieur revient à diminuer la production et à la remplacer par des importations. Les interactions entre politique macroéconomique et déséquilibres extérieurs, centrales pour Keynes via le rôle de la demande agrégée, conduisent à devoir arbitrer entre relance de la demande et déficit commercial.
Dans le cadre des plans de relance en Europe l’enjeu sera de rééquilibrer la demande dans la zone de façon durable. Car les déséquilibres qui se sont installés, avec un excédent courant allemand massif et des déficits courants en France et dans les pays du Sud, ne sont pas sans lien avec les politiques de compression de la demande d’un côté, et de stimulation de l’autre, qui ont été menées ces dernières années.
Les changements majeurs de politiques fiscale et sociale intervenus en Allemagne au début des années 2000 sont à l’origine du tournant observé à ce moment-là dans l’évolution du solde courant allemand : déficitaire dans les années 1990, il est depuis quatre ans le plus élevé au monde autour de 7 % du PIB.
Hausses d’impôts indirects payées par les classes moyennes et modestes dont la propension à consommer est la plus élevée, réforme du système des retraites vers moins de générosité du système par répartition et plus de capitalisation ont tari la demande intérieure et fait exploser l’épargne. Et si cela ne s’est pas traduit par une chute de l’activité, c’est parce que, ailleurs, au sud de l’Europe ou aux États-Unis, certains étaient prêts à dépenser plus qu’ils ne gagnaient, grâce à des politiques de soutien de la demande.
Aussi pour éviter que la relance en Europe ne conduise à une nouvelle accélération de la désindustrialisation en France, il est indispensable que l’Allemagne prenne sa part de stimulation de la demande. Cela réclamera que le mouvement qu’elle a engagé en ce sens se consolide. C’est donc bien au niveau macroéconomique et européen, par la coordination des plans de relance et le rééquilibrage de la demande, que se jouera pour beaucoup l’avenir des dynamiques industrielles.
TC : On a le sentiment que la pandémie agit comme un accélérateur de changement, comme si dans cette catastrophe il y avait tout de même des aspects postifs…
C’est vrai, des décisions de politique économique qui hier paraissaient impossibles relèvent aujourd’hui de la nécessité ; outre la prise de conscience des vulnérabilités associées aux formes que la mondialisation a prises ces dernières décennies, poussant un cénacle plus large à se demander si cela n’a pas été poussé trop loin, il y a par la force des choses une réhabilitation du rôle des États, aux commandes de la politique économique.
Cela étant, il est aussi des phénomènes structurels qu’elle ne changera pas, voire qu’elle pourrait aggraver. Il en ira ainsi de la concentration, qui pourrait s’accentuer sous l’effet de cette crise en raison des faillites qu’elle va entraîner et qui ne feront que creuser l’écart entre les petites entreprises à faible pouvoir de marché et les grandes dont la domination s’en trouvera renforcée.
La concentration est l’un des phénomènes emblématiques des dernières décennies, particulièrement sensible aux États-Unis et dans une moindre mesure en Europe. D’aucuns y voient le jeu bénéfique de la concurrence, où les entreprises les plus productives l’emportent ; d’autres, au contraire, un déclin de la concurrence.
Dans le livre, Axelle Arquié et Julia Bertin, lèvent le voile sur la réalité complexe du phénomène, dont l’évolution diverge sur le marché des biens et sur celui de l’emploi. Elles n’adhèrent pas à la thèse de la concentration vertueuse, soulignent que les salariés et les consommateurs y perdent au profit des actionnaires, et mettent en garde contre le danger d’un démantèlement des régulations protectrices européennes.
TC : La crise sanitaire empêchera-t-elle la mise en place d’un Green New Deal global ou, au contraire, fera-t-elle prendre conscience de l’impérieuse nécessité de sauver le climat ?
Les périodes de crise sont rarement propices aux politiques environnementales, mais celle qui a frappé cette année l’économie mondiale, parce qu’elle est venue souligner le dérèglement de nos rapports à la nature et nous rappeler notre vulnérabilité, pourrait bien conduire à un tournant décisif dans l’engagement en faveur de la transition écologique.
Le défi à relever est immense, car, pour Michel Aglietta et Étienne Espagne, il ne s’agit pas seulement de corriger une défaillance de marché par l’établissement d’un prix du carbone, mais bien de s’inscrire dans un modèle de croissance radicalement différent, comme l’avait fait en son temps le New Deal de Franklin D.
L’enjeu étant global, le Green New Deal ne peut que l’être aussi. Il réclamera notamment de contenir la dissociation spatiale entre les émissions de gaz à effet de serre produites et consommées, permise par le commerce international, pour éviter que les réductions d’émissions au Nord ne se fassent aux dépens du Sud. Il réclamera aussi un engagement des institutions financières du Nord pour soutenir les Green New Deal des pays du Sud.
Car, dans un système monétaire international dominé par le dollar et dans un contexte de mobilité des capitaux, la nécessité pour les économies émergentes de constituer des réserves importantes en dollar n’est pas sans faire obstacle à la mise en place de stratégies de long terme d’investissements publics transformateurs comme ceux que nécessite le Green New Deal pour respecter les limites planétaires.
TC : Mais avec la dépréciation du dollar depuis la crise sanitaire et le plan de relance européen adopté fin juillet, l’hégémonie du dollar n’est-elle pas quelque peu menacée ?
Si l’on regarde comment le dollar est devenu la monnaie internationale de référence que la fin du système de Bretton Woods n’a pas remise en cause, que l’on examine sa place dans la plupart des fonctions qu’une monnaie internationale se doit d’assumer et les alternatives à sa suprématie dans un monde où le poids économique des États-Unis s’amenuise, difficile de ne pas penser, avec Carl Grekou, que, hier comme aujourd’hui, aucun concurrent sérieux ne menace le billet vert.
L’euro souffre de lacunes qui compromettent toujours son rôle de devise clé et, si le plan de relance européen constitue un tout premier pas vers une union budgétaire dont pourrait émerger un marché de titres de dette mutualisée, le chemin est encore long pour y parvenir.
Les monnaies digitales, parce qu’elles menacent un privilège que les États ne sont pas près d’abandonner, auront du mal à voir le jour. Quant au renminbi, nouveau concurrent désigné, il reste encore trop étroitement lié au dollar pour prétendre s’y substituer, en tout cas à court terme.
TC : Mais pourtant la Chine met depuis quelques années tout en œuvre pour assoir la crédibilité internationale de son système financier, ce qui devrait faciliter l’internationalisation de sa monnaie, non ?
En effet, et même si la pandémie retarde les réformes et l’ouverture du système financier, la détermination de la Chine à occuper une place de premier plan sur l’échiquier, aussi bien économique que financier, mondial n’est pas entamée pour autant.
Depuis la crise financière de 2007-2008, le développement du secteur bancaire et financier chinois s’est accéléré. Avec son secteur bancaire devenu le plus grand du monde, la Chine a transformé en l’espace d’une décennie les contours du système financier mondial. Elle doit toutefois contenir l’expansion d’un vaste secteur de l’ombre, opaque et vecteur de risque systémique, et l’explosion du taux d’endettement des ménages et des entreprises.
Il lui faut aussi renforcer la sophistication de ses marchés financiers et rationaliser les grandes entreprises d’État pour avoir la confiance et la reconnaissance des investisseurs internationaux. Les Nouvelles routes de la soie ont fait avancer son processus d’internationalisation, surtout vis-à-vis des pays qui ont besoin de financer leur développement. Mais la Chine a encore devant elle un long chemin avant de voir émerger un pôle monétaire autour du renminbi, qui remettrait en question l’hégémonie du dollar au sein du système monétaire international.
TC : Au final, une pandémie qui va irréversiblement rebattre les cartes de l’économie mondiale ?
Surtout une pandémie qui laisse l’économie mondiale face à de nombreux défis. En tout premier lieu, celui de parvenir à faire en sorte que les économies se relèvent de ce choc. Celui de rebâtir une mondialisation qui tire profit des interdépendances tout en se préoccupant des vulnérabilités qu’elles engendrent. Celui de rééquilibrer la demande en zone euro pour assurer sa pérennité. Celui de sauver le climat par la mise en place d’un régime de croissance radicalement différent.
Autant de défis auxquels les réponses qui seront apportées détermineront pour longtemps la trajectoire de l’économie mondiale.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

